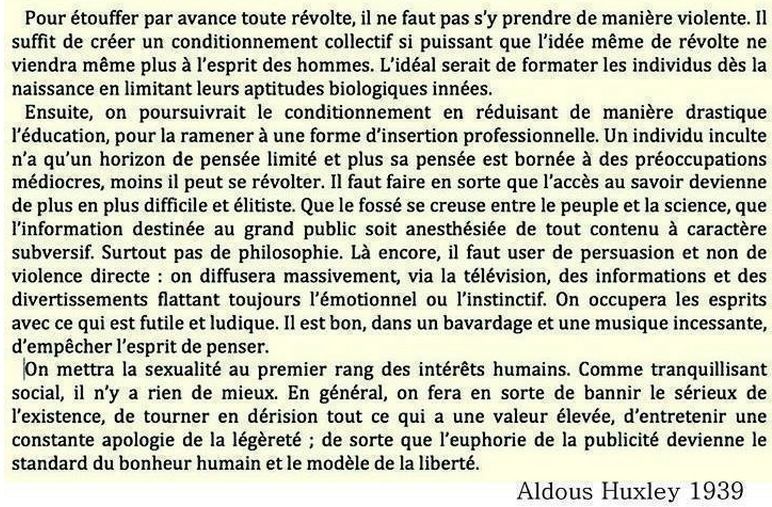«Tant que les passions et les intérêts subsisteront parmi les hommes, écrit Edward Gibbon dans son formidable tableau du déclin et de la chute de l'Empire romain, les mêmes questions débattues dans les conseils de l'Antiquité relativement à la paix ou à la guerre, à la justice ou à la politique, se représenteront fréquemment dans les délibérations des conseils modernes; mais le plus habile ministre de l'Europe n'a jamais eu à considérer l'avantage ou le danger d'admettre ou de repousser une innombrable multitude de barbares contraints par la faim et par le désespoir à solliciter un établissement sur les terres d'une nation civilisée.»
Nous sommes en 376. Venue des steppes de l'Oural, une peuplade inconnue a franchi la Volga et le Don, subjugué le peuple des Alains et dévasté l'empire des Goths greuthinges, qui s'étendait, au nord de la mer Noire, sur le territoire de l'Ukraine. Ce sont les Huns. Ces archers redoutables, juchés sur de petits chevaux et vêtus de peaux de chèvres, envahissent et ravagent bientôt le royaume des Goths tervinges, dans l'actuelle Moldavie. Ceux-ci ne trouvent leur salut que dans la fuite. Avec les débris de ce qui fut le puissant peuple des Greuthinges, auxquels se sont joints des groupes d'Alains et de Huns en rupture de ban, ils se pressent sur la rive du Danube, qui forme la frontière de l'Empire romain. «Là, debout sur les berges, dit l'historien Eunape, ils tendaient les mains en lançant des lamentations et des cris.»
On en doute: comme le remarque Alessandro Barbero, «il n'était peut-être pas facile de se faire entendre d'une rive à l'autre du Danube avec un courant en pleine crue.» Plus concrètement, leurs chefs adressent à la cour impériale une supplique qui demande qu'on les laisse entrer en réfugiés dans l'Empire, promettant d'y vivre paisiblement et de fournir des troupes auxiliaires à l'armée romaine.
A Antioche, où se trouve alors l'empereur d'Orient, Valens, cette demande d'asile de tout un peuple «inspira plus d'allégresse que de crainte», raconte avec colère Ammien Marcellin. «Les flatteurs patentés portaient aux nues la Fortune de l'empereur, qui tirait de la terre tant de jeunes recrues pour les lui offrir, quand il ne les attendait pas; ainsi, il pourrait, avec ses forces et celles des étrangers réunies, disposer d'une armée invincible, et à la place du renfort en soldats que chaque province lui payait annuellement, il verrait un monceau d'or considérable s'ajouter aux Trésors.»
Il est vrai que l'Empire manque cruellement d'hommes: il lui faut des bras en grand nombre pour faire tourner une économie élémentaire, agricole; d'autres lui sont nécessaires pour constituer les armées affectées à la défense des immenses frontières qui s'étendent, sur des milliers de kilomètres, le long du Danube et du Rhin. A la crise démographique latente, malthusienne, qui a creusé les courbes de sa population dès les deux premiers siècles de notre ère, a succédé au IIIe siècle un véritable dépeuplement, dû à une succession d'épidémies et de guerres provoquées par les raids de pillage des Germains, qui ont profité de l'instabilité politique pour dévaster en profondeur le territoire romain.
Le retour à l'ordre imposé, au IVe siècle, par Constantin et les empereurs chrétiens n'a pas suffi à redresser, dans ce domaine, la situation; des provinces sont dépeuplées; des terres restent désertes. Les empereurs peinent à recruter des soldats dans une population clairsemée et déshabituée aux disciplines de la guerre. Tous citoyens romains depuis le début du IIIe siècle, les habitants de l'Empire ne se soucient guère d'embrasser une condition militaire qui n'apporte plus ni privilège (elle permettait autrefois d'acquérir la citoyenneté romaine) ni butin. Les propriétaires terriens répugnent de leur côté à livrer à la conscription les paysans dont ils ont besoin pour cultiver leurs terres. Valens s'apprête, alors, à entrer en campagne contre les Perses. Son armée de campagne est trop éloignée de la frontière du Danube pour tenir en respect ceux qui s'y pressent. Accueillir les guerriers goths qui lui demandent asile, c'est dans ces conditions faire montre de magnanimité, de bienveillance, mais aussi de réalisme, et à ses yeux servir, en lui procurant des recrues et de la main-d'œuvre, les intérêts bien compris du monde romain.
__________________
L'affaire n'est, au demeurant, nouvelle que par ses proportions. Elle a eu, sur une autre échelle, nombre de précédents. L'Empire romain n'a pas attendu en effet ce qu'on désigne comme «les grandes invasions» pour admettre sur son territoire des populations barbares venues de Germanie. C'est au contraire pour lui une longue tradition.
Agrippa avait été le premier à donner, en 39 avant J.-C.,refuge à une tribu d'au-delà du Rhin: celle des Ubiens. Alliés de César pendant la guerre des Gaules, celtes par leur culture et par leur mode de vie, ils avaient été, pendant les guerres civiles, victimes des razzias de leurs voisins. Octave avait accepté leur installation sur la rive gauche du Rhin en les chargeant de surveiller la frontière. En 8 avant J.-C., Tibère avait renouvelé l'expérience en déportant, cette fois, des ennemis vaincus: 40000 Suèves et Sicambres qui s'étaient livrés à merci. Treize ans plus tard, Sextus Elius Catus avait installé 50000 Daces en Mésie. Sous Claude, un roi barbare renversé par ses neveux avait reçu l'autorisation de passer en Pannonie avec ses clients, qui y avaient reçu des terres. Sous Néron, 100000 trans-Danubiens fuyant leurs ennemis sarmates avaient été accueillis en Mésie. Plus encore qu'à des préoccupations militaires, cette politique d'accueil semble avoir répondu au désir de bénéficier de l'apport de populations sédentaires pour relancer l'agriculture dans des zones désertiques.
Le procédé avait pris une ampleur nouvelle sous Marc Aurèle, après que nombre de provinces frontières eurent été dévastées par la peste. Certains déplacements avaient tenu de la déportation de peuples vaincus; d'autres relevaient de l'asile accordé à des tribus alliées fuyant leurs ennemis.
La pratique se généralise à la fin du IIIe siècle afin de repeupler les provinces frontières au lendemain des invasions dont l'Empire a été la victime. Pour assurer la stabilité des frontières face aux raids de pillage, les empereurs alternent en effet les expéditions punitives destinées à montrer la puissance de Rome et la sédentarisation de populations nomades sur des terres dont ils veulent croire qu'elles auront à cœur de les mettre en valeur et de les défendre contre de nouveaux venus. Ils recrutent en outre des Barbares en grand nombre dans l'armée romaine. «Les propriétaires ruinés, les impôts impayés, les récoltes incomplètes, et la vie de l'Empire pouvait se trouver arrêtée, remarque Fustel de Coulanges. L'Empire lutta pendant trois siècles contre cette difficulté; l'adjonction de laboureurs germains était son salut. Aussi trouvait-on qu'il n'y en avait jamais assez, et ne se contentait-on pas de ceux qui offraient leurs services. On profitait de chaque victoire pour en introduire de force le plus qu'on pouvait, à la grande satisfaction des propriétaires du sol.»
Cette politique a, comme on l'imagine, ses apologistes et ses doctrinaires: «Ainsi, se réjouit le panégyriste de Constance Chlore, c'est donc pour moi que labourent, à cette heure, le Chamave et le Frison, que ce vagabond et ce pillard peine à travailler sans relâche mes terres en friche, peuple mon marché de bétail qu'il vient vendre, et que le laboureur barbare fait baisser le prix des denrées.» «La capacité à procurer des recrues et plus généralement, de la main-d'œuvre, grâce aux victoires remportées sur les Barbares, souligne Alessandro Barbero dans la formidable somme qu'il a consacrée à la question de l'immigration dans l'Empire romain, devient à cette époque l'un des devoirs de tout bon empereur.»
Frappée en 350 par l'empereur Constant, une monnaie témoigne de ce tournant: au contraire des figures traditionnelles du barbare piétiné et criblé de flèches ou traîné par les cheveux, les mains liées derrière le dos, par un légionnaire, elle représente un Romain faisant sortir un barbare de sa hutte en le tenant pacifiquement par la main.
Tout au long du IVe siècle, les empereurs suivront, en la matière, cet exemple, convaincus que, décidément, l'immigration est une chance pour l'Empire romain.
_____________________
Lorsqu'en 376, chassés de leur royaume par l'irruption des Huns, les Goths se présentent en masse sur les rives du Danube pour demander asile en suppliant, l'empereur Valens ne croit donc pas devoir fournir l'effort militaire exceptionnel qui serait nécessaire pour refuser à leur peuple l'accès au territoire romain. Il organise au contraire leur transfert, escomptant qu'ils lui procureront un réservoir de main-d'œuvre et surtout, de soldats aguerris pour étoffer les rangs de ses légions. La traversée n'est pas facile. Elle va se faire dans la plus grande confusion. Des pluies continuelles ont prodigieusement élargi le cours du fleuve. Une foule de bateaux, de radeaux, de troncs d'arbres creusés passent et repassent le Danube. Des milliers de guerriers barbares, escortés de leurs femmes, leurs enfants, leurs esclaves, entrent sans coup férir dans l'Empire, tandis que les rives du fleuve se transforment en un immense camp de réfugiés où les migrants sont la proie des violences, des chantages et des exactions. Jour et nuit, de nouveaux arrivants se présentent: la nouvelle s'est répandue que la frontière de l'Empire est ouverte. On s'y précipite pour profiter de l'aubaine. «Et un soin diligent, note avec amertume Ammien Marcellin, était déployé pour ne pas abandonner à l'arrière un seul de ces hommes destinés à renverser la puissance romaine».
Les Goths n'ont pas été, de fait, admis dans le contexte d'une écrasante supériorité romaine, comme l'étaient, à l'ordinaire, les Barbares, mais bien acceptés dans l'urgence, sous la pression du nombre. Ils n'ont été ni dispersés (pour casser les solidarités tribales), ni désarmés, ni déportés dans une province lointaine, comme on avait accoutumé de le faire.
Indignés par le désordre et la confusion dans lesquels ils ont été (mal) accueillis (rien n'a été prévu pour assurer leur subsistance et les habitants des villes se retranchent derrière leurs murailles à leur approche en les invitant à passer leur chemin), restés soudés, en armes, derrière leurs chefs traditionnels, ils ne tarderont pas à se révolter contre les autorités romaines. A Andrinople, en 378, ils détruiront l'armée chargée de les ramener à la raison lors d'une bataille sanglante au cours de laquelle périra l'empereur lui-même. Et son successeur Théodose ne parviendra à rétablir l'ordre qu'en signant avec eux, en 382, au terme de trois ans de guerre, une paix de compromis qui leur permettra de s'installer, en armes, invaincus, sur le sol romain.
«Voyez comme le nom des Goths est désormais aimé, comme il est plaisant, agréable, s'émerveillera, nullement découragé par l'expérience, le rhéteur Thémistius (...) Pour eux, la philanthropie l'emporte sur la destruction (...) Déjà, les Barbares transforment leurs armes en bêches et en faux, ils cultivent les champs, et s'ils manifestent un distant respect à Arès, ils adressent leurs prières à Démeter et à Dionysos.»
Dix ans plus tard, Alaric, un jeune prince de vingt ans, se fera un nom en prenant leur tête pour piller les Balkans. En 401, il assiégera l'empereur à Milan. Neuf ans encore, et il fera le sac de Rome.
Le Figaro, Michel De Jaeghere le 14 octobre 2015
Directeur du «Figaro Hors-Série» et du «Figaro Histoire», Michel De Jaeghere a travaillé durant quinze ans sur les circonstances de la chute de l'Empire romain d'Occident, dont il a relaté Les Derniers Jours, un livre de référence paru en 2014.
/image%2F1457555%2F20150316%2Fob_e2ea02_fotolia-4076130-subscription-l.jpg)
.gif)
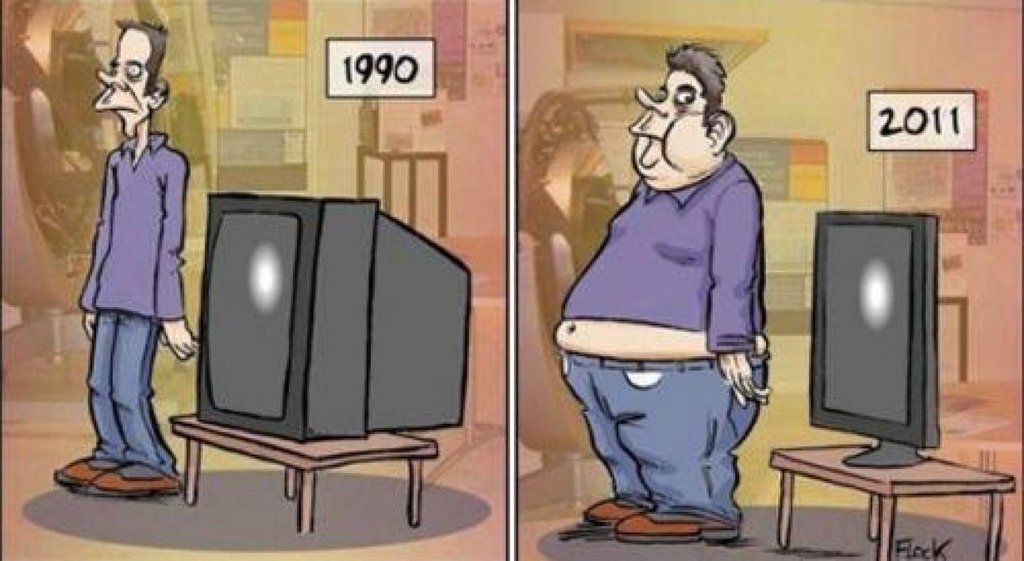



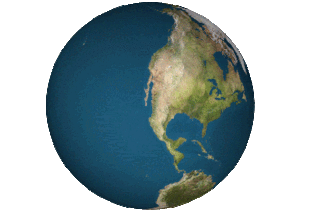






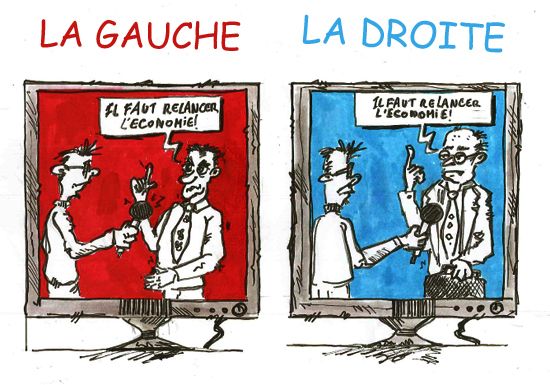


/http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FkJuyLs-TKpA%2Fhqdefault.jpg)