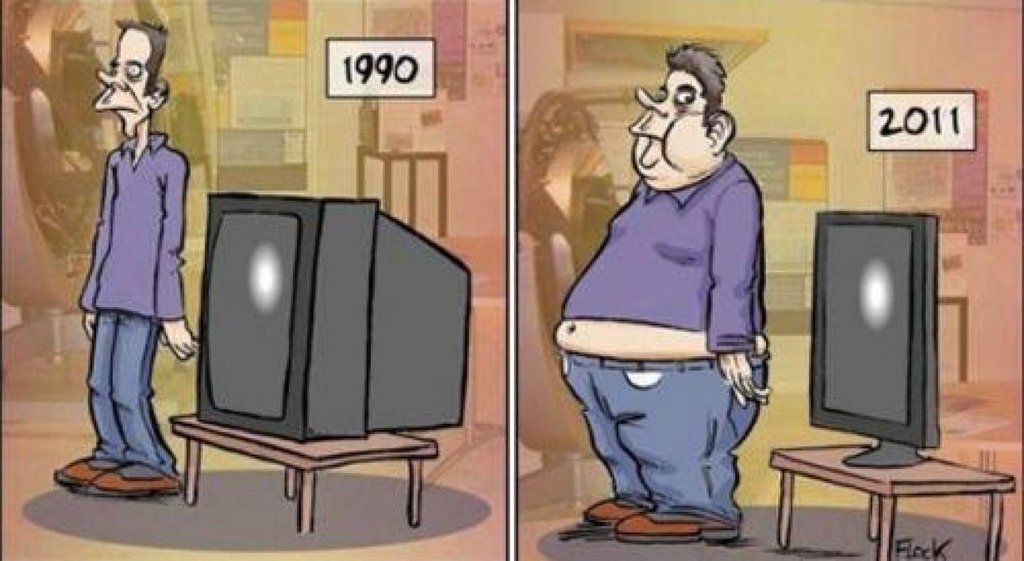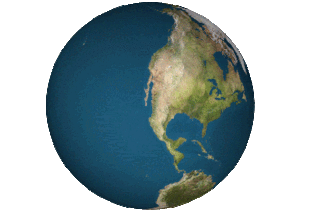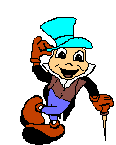L’économie américaine est celle d’un géant qui dépasse en taille et en poids tous les autres pays du globe. Mais elle est aujourd’hui menacée par une fragilité accrue et un endettement massif envers les autres pays. Plus qu’une économie impériale, les Etats-Unis développent une dépendance croissante envers le reste du monde.
S’il est un secteur qui résume et symbolise à la fois l’hégémonie américaine, c’est bien celui de l’économie. En la matière, les Etats-Unis sont un géant qui dépasse, par la taille et par le poids, tous leurs concurrents.
Le PIB américain, 12 400 milliards de dollars en 2005, représente autant que celui des sept autres économies réunies au sein du G8 (Allemagne, Canada, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Russie). Et cette prépondérance est loin de s’affaiblir. Entre 1997 et 2001, le PIB américain a augmenté de 23 %. Aucune autre économie du G8 n’a fait mieux.
L’économie a joué un rôle central dans l’accession des Etats-Unis au statut de puissance impériale. En effet, ce n’est pas un plan délibéré de conquête territoriale mais la domination de fait résultant de la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a consacré le leadership américain sur le monde. Le PNB américain représentait alors plus de la moitié du produit brut mondial. L’avènement d’un nouvel ordre international était nécessaire. Il s’est logiquement décentré de l’Europe, exsangue, pour trouver sa place auprès de la première puissance économique mondiale. La prédominance économique américaine ne date donc pas des années 1990. Dès la fin du xixe siècle, les Etats-Unis ont accédé au rang de première puissance industrielle du monde. En 1913, ils représentaient déjà plus du tiers de la production industrielle mondiale.
Au lendemain de la dernière guerre mondiale commence une période faste qu’on peut qualifier d’« american dream ». « Au milieu des années 1960, l’Amérique gérait une sorte d’étrange hybride des anciens Empires romain et britannique, souligne le politiste Pierre Mélandri. Elle avait repris le rôle de chantre du libre-échange, de fournisseur en ressources financières et d’ordonnateur du système monétaire longtemps assuré par l’Angleterre (1). » Les firmes états-uniennes multiplient alors implantations et rachats à l’étranger, le dollar accède au statut de devise étalon et de monnaie d’échange internationale.
Cette superpuissance économique permet d’assurer également une importante présence militaire à l’étranger, qui renforce à son tour la présence économique américaine dans le monde. Les alliés sont aussi la plupart du temps des clients.
Avec la fin de la guerre froide, l’économique prend encore davantage le pas sur le militaire. L’hégémonie économique convient en fait bien mieux aux Etats-Unis que l’empire militaire, qui comporte des coûts financiers et humains importants. Les Américains ne sont pas prêts à sacrifier le niveau de vie acquis grâce à leur économie pour mener une politique véritablement impériale et agressive. Sur une échelle de temps longue, la domination de soft power*, par le commerce notamment, a leur préférence, plus que la conquête guerrière. L’invasion de l’Afghanistan puis celle de l’Irak sous la présidence de George W. Bush ont pu donner une image plus belliqueuse de l’Amérique, mais méfions-nous des effets de loupe dus au contexte et à l’actualité du moment.
Qui se souvient aujourd’hui des analyses qui faisaient florès, jusqu’à la veille de la chute du mur de Berlin, sur le déclin inexorable de l’économie américaine ? A plusieurs reprises au cours de son histoire, le pays a connu de sévères crises. La plus importante d’entre elles fit suite au krach boursier de 1929 avec une chute de moitié de la production industrielle jusqu’en 1933. Dans les années 1970-1980, plusieurs analystes crurent voir dans la désindustrialisation des Etats-Unis l’amorce d’une phase de déclin (2). Gardons-nous d’exagérer la toute-puissance de l’économie américaine aussi bien que ses faiblesses.
Les années 1990 ont propulsé la puissance américaine à un niveau tel qu’il a permis le lancement de la « révolution capitaliste » sur la quasi-totalité de la planète, relayée dès le milieu de la décennie par un essor économique et des succès technologiques conséquents. Mais les années 2000 ont mis au jour des fragilités, en fait latentes depuis plusieurs décennies. La guerre froide a impacté l’économie américaine et produit des déséquilibres qui ne se sont pas résorbés depuis la fin du conflit mais se sont accentués (3).
Du chant du déclin à celui de l’hégémonie
Le premier de ces déséquilibres concerne le commerce. Apparu dès le début des années 1970 comme un élément structurel de l’économie mondiale, le déficit commercial est passé de 100 à 450 milliards de dollars entre 1990 et 2000 pour atteindre 719 milliards de dollars en 2005. Viennent ensuite les finances publiques. Depuis l’intervention en Afghanistan et surtout la guerre en Irak, le déficit budgétaire atteint lui aussi des niveaux abyssaux (plus de 400 milliards prévus en 2006).
Corollaire de ces deux déficits, l’endettement du pays ne cesse de grossir pour atteindre des sommets vertigineux. La dette publique se monte à 8 000 milliards de dollars en 2005, soit près de 70 % du PIB, et la dette externe* à 8 800 milliards de dollars.

Non seulement les Etats-Unis sont endettés, mais ils ne peuvent pas faire appel à l’épargne domestique pour trouver des crédits. Les ménages américains sont, eux-mêmes, très endettés (117 % du revenu disponible en 2003). Ce fort endettement est aujourd’hui compensé par la hausse de l’immobilier. Plusieurs experts soulignent cependant la fragilité d’un tel équilibre qui ne pourra qu’être rompu si le marché de l’immobilier se retourne. En tout état de cause, l’« hyperpuissance américaine » n’a pas d’autre choix que de faire appel à des bailleurs étrangers. Or, aujourd’hui, ces bailleurs sont aussi les puissances susceptibles à terme de remettre en cause le leadership américain, à commencer par la Chine.
Ce sont en effet principalement les banques centrales asiatiques qui financent les emprunts américains : le Japon pour 800 milliards, la Chine pour 320 milliards. Celle-ci est en effet assise sur un trésor de réserves de changes (900 milliards de dollars) acquis grâce aux excédents qu’elle dégage avec le commerce américain. La première économie du monde se finance de plus en plus aux frais de pays plus pauvres parce qu’elle représente, en tant que marché, le principal débouché pour ces économies en forte croissance. L’historien Emmanuel Todd voit ainsi dans le déficit commercial des Etats-Unis « un prélèvement impérial » qui permet aux Américains de consommer tandis que le reste du monde produit et épargne (4). C’est faire fi de la dépendance d’une telle relation. « Les Etats-Unis dépendent, pour 10 % de leur consommation industrielle, de biens dont l’importation n’est pas couverte par des exportations de produits nationaux », remarque le même E. Todd. Ironiquement, la capacité de financement de l’Asie est devenue un élément clé de la prospérité américaine.
Dans un monde global, tant que les déséquilibres sont acceptés de part et d’autre et que chacun y trouve son compte, les fragilités sont, pour ainsi dire, partagées. Le système conserve une certaine stabilité, mais cela a un prix : une plus grande contrainte due à l’interdépendance. Le paradoxe de l’économie américaine, c’est qu’elle n’a cessé sur le long terme de conférer aux Etats-Unis une influence grandissante dans les affaires du monde. Et aujourd’hui, alors que le pays s’affirme comme plus puissant que jamais, l’économie apparaît comme le premier domaine dans lequel les Etats-Unis subissent, et de facto acceptent, une entrave à leur souveraineté tant grandit leur dépendance vis-à-vis du reste du monde.
NOTES
(1) P. Mélandri, « Les États-Unis : un empire qui n’ose pas dire son nom ? », Cités, n° 20, 2004.
(2) Voir P. Kennedy, Naissance et déclin des grandes puissances, Payot, 1996.
(3) E. Todd, Après l’empire. Essai sur la décomposition du système américain, Gallimard, 2002.
(4) Ibid.
/image%2F1457555%2F20150316%2Fob_e2ea02_fotolia-4076130-subscription-l.jpg)
.gif)